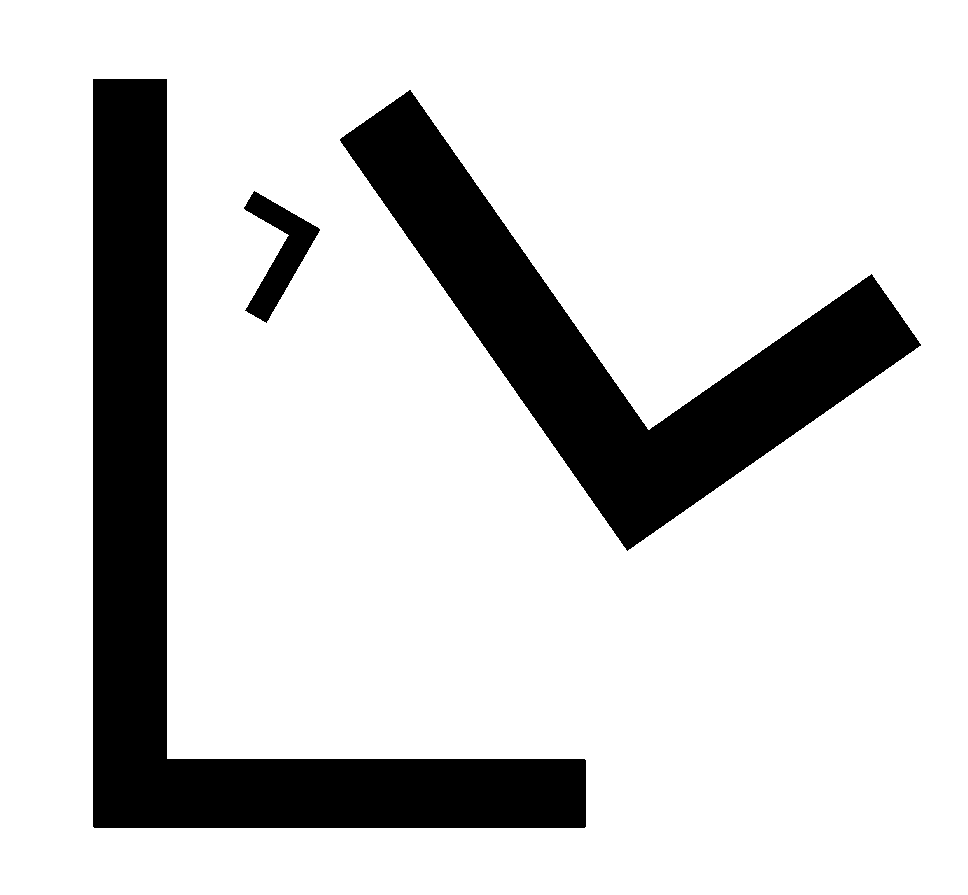Natacha Romanovsky

Photo: © Natacha Romanovsky
Recherche en cours
Nous sommes Nature… Tel était le point d’arrivée de ma première recherche à L’L… Et le point de départ de cette seconde. Avec la différence que je me concentre cette fois, non plus sur l’humain, mais sur le non-humain : le végétal, l’animal, le minéral, l’atmosphérique…
Mais comment parler du non-humain en tant qu’humain ?
Quelles pratiques adopter pour aller à la rencontre de ce non-humain ?
Par des explorations dans le grand dehors (la « nature », dit-on aussi) et par des expérimentations au plateau nourries de ces premières, ma démarche consiste à chercher des voies pour parler non seulement du non-humain, mais aussi (voire surtout) pour entrer en communication avec le non-humain dans la reconnaissance de son altérité, afin de déconstruire le paradigme qui place l’humain au-dessus et en-dehors de tout ce qui existe, créant une soi-disant « réalité » établie comme vérité absolue, qui n’est en fait qu’un « hors-monde » où l’humain flotte, déconnecté de ce qui façonne réellement le monde.
Mon travail d’exploration dans le grand dehors a pour objectif de développer un certain type d’attention, une awareness. Seul ce terme anglais permet d’englober les différents degrés dont il est question ici : la conscience de (mais non réflexive), le savoir (mais non théorisé), la capacité de se focaliser sur, la sensibilité (dans une globalité), l’expérience de.
Une telle awareness me paraît indispensable pour nous positionner au cœur de notre véritable état d’humain – ce positionnement étant la seule voie possible pour vivre bien maintenant, et envisager un avenir acceptable (considérant l’approche contemporaine « moderne », « occidentale », du monde comme inacceptable), un devenir décolonisé des systèmes mortifères qui voudraient nous faire tolérer l’inadmissible.
À partir de ces expériences in situ dans lesquelles mon corps et mes sens sont mes premiers outils, je cherche les moyens (les langages, les médiums, les modalités) pour les transposer – et les transmettre – dans le dedans du plateau. Ici aussi, il s’agit avant tout pour moi d’un travail sur l’attention : répondre à la nécessité de donner à (perce)voir la densité du monde (densité à comprendre ici comme un enchevêtrement de complexités d’existences, vivantes, non-vivantes, et aux temporalités multiples) en tentant en particulier de déconstruire des notions trop souvent utilisées pour parler de la « nature ». Des notions telles que le silence et la solitude (« Croire que nous sommes seuls, c’est se tromper de monde »*) ou encore, celle du paysage, qui réduit le grand dehors en un décor inerte.
Par-là, je cherche à raconter des histoires qui convoquent des présences autres, des histoires qui réactivent le sensible, qui contiennent le monde non-humain au lieu de l’éliminer, des histoires qui procèdent par additions plutôt que par soustractions. Ces histoires peuvent êtres musculaires, sonores, parlées, écrites, tracées, dessinées… Elles peuvent être récoltées, imaginées… Ou tout cela à la fois…
Il est grand temps de cesser de se méfier de l’expérience sensible et d’entamer des dialogues cohérents avec toutes les formes d’existences qui composent la chair du monde, « Il faut penser avec son corps terreux »**. C’est autant une question d’éthique, de respect, de dignité que de responsabilité.
Prendre en charge notre véritable humanité ne se fera pas sans connexion avec ce qui n’est pas humain ni sans rendre sa véritable présence à ce qui n’est pas humain. En somme, il serait bon de commencer à rentrer dans l’Ubuntucène. Terme qui peut sembler énigmatique, mais qui est très signifiant à mon sens : « ubuntu » est un concept utilisé dans différentes langues bantoues d’Afrique australe, qui évoque entre autres le lien entre chaque individu, le lien avec les autres, l’interconnexion, l’interdépendance, l’attention portée aux autres, un « je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes » qui se joue dans un constant réajustement créatif.
Natacha Romanovsky, octobre 2023
*Olivier Remaud, Penser comme un iceberg, Actes Sud, 2020
** Carol Bigwood, Earth Muse: Feminism, Nature and Art, Temple University Press, 1993, citée et traduite dans l’ouvrage de Pascale d’Erm, L’écoféminisme en questions, Éditions La Plage, 2021.

Photo: © Pierre Liebaert
Parcours à L'L
Suite à un dépôt de candidature, Natacha Romanovsky entre à L’L et entame une première recherche en mars 2015, avec comme point de départ l’ouvrage de Théodore Monod, Et si l’aventure humaine devait échouer. Cette recherche se termine en juillet 2020.
Natacha démarre sa seconde recherche en janvier 2021.
Natacha Romanovsky est née dans le courant des années 1970 à cet endroit : latitude 50° 48’ 0” Nord ; longitude 04° 19’ 60” Est.
Venue au monde à une altitude d’environ 47m, rien ne la prédestinait à arpenter les montagnes.
Quand elle eut atteint 1,72 m, elle finit dignement ses études d’anthropologie, suivies en parallèle d’études de cirque, et décida dans l’ascenseur du Bâtiment C de l’ULB d’opter plutôt pour le monde des arts que pour celui de la cohabitation avec de lointaines ethnies.
Elle passa beaucoup de temps dans les vagues (océanes et émotionnelles), mais l’élément le plus marquant de son début de vie furent les 12.000 km parcourus entre la capitale belge et la capitale tibétaine durant l’année qui vit la création du territoire du Nunavut au Canada et le naufrage de l’Erika. Natacha atteignit cette année-là l’altitude de 5.700 m sur de faibles jambes et dans d’assez désagréables conditions.
Elle s’est ensuite précipitée sous chapiteau à l’école de cirque de Madrid (latitude 40° 24’ 59” Nord ; longitude 03° 42’ 09” Ouest ; altitude 667 m) et fut prise dans un tourbillon de pompages, d’abdominaux, de verticales, d’équilibres, de liberté et d’amour.
S’en est suivi une micro carrière de circassienne, arpenteuse de festivals ; une vanlife entre bohème et engagements.
Il y eut aussi des errances, beaucoup de voyages, de déplacements, beaucoup, et de l’écriture – ayant été contaminée en 1994 par la lecture de Jack kerouac et n’arrivant pas à guérir d’un mal qui lui convenait très bien.
Courbaturée, vers sa trentième année, Natacha se réorienta vers la danse contemporaine, et d’improvisation, à Rome (latitude 41° 53’ 30” Nord ; longitude 12° 30’ 40” Est ; altitude 52 m).
Encore plus courbaturée, et à l’approche de sa moitié de trentaine, elle se réorienta à nouveau vers le théâtre, à Paris (latitude 48° 51’ 12” Nord ; longitude 02° 20’ 55” Est ; altitude 47 m).
Ensuite, à l’approche de sa quarantaine, révoltée contre le manque de corporalité chez les acteurs, elle se mit à table pour écrire.
L’artistique perdait le corps… mais… elle se mit à courir les montagnes et les océans.En quête d’une existence à la Benjamin Button, Natacha augmente les difficultés physiques avec les années.