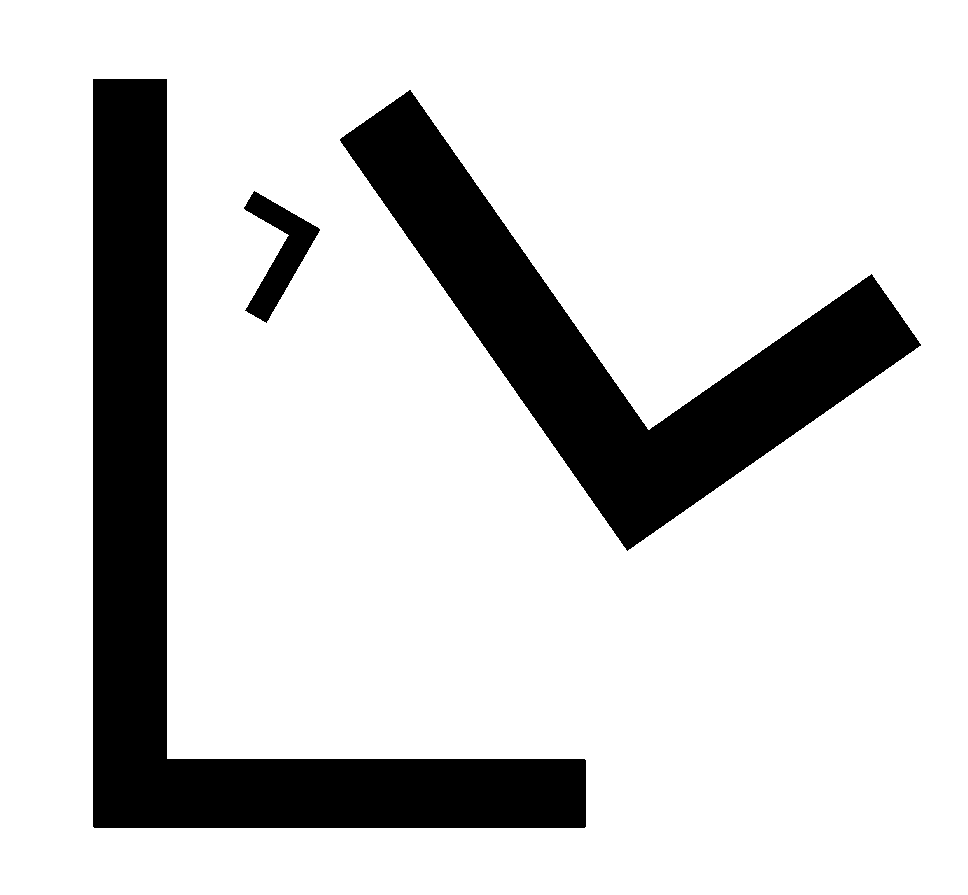Sarah Hebborn
![recadrée [Scène_extérieure_avec_acteurs_costumés]_[...]Clément-Maurice_(1853-1933)_btv1b69043234_1-2 2](https://www.llrecherche.be/wp-content/uploads/2023/02/recadree-Scene_exterieure_avec_acteurs_costumes_...Clement-Maurice_1853-1933_btv1b69043234_1-2-2.jpeg)
Recherche en cours
J’ai une histoire avec la fiction. Une envie de croire en sa nécessité, malgré le caractère complexe qu’elle revêt.
La fiction peut agrandir nos imaginaires ou, au contraire, les soumettre, les dominer. Elle est instrumentalisée depuis la nuit des temps par les puissants. Elle est partout.
Il est évident que les fictions dominantes sont dévastatrices pour la plupart des êtres. L’avenir est terrifiant.
Nous sommes comme en suspens, coupés de toute prise autre qu’imaginaire, dans une réalité rétrécie, aux vitres incassables et aux portes verrouillées¹.
Créer d’autres récits qui nourrissent d’autres façons d’être au monde, c’est créer des possibles.
Si l’on tend à nous faire voir un seul récit, celui du capitalisme, comme étant l’unique qui puisse être entendu, la riposte ne serait-elle pas du côté du multiple ?
J’aimerais quitter le récit linéaire et l’approche aristotélicienne du propos. Je ne veux pas créer de rhétorique qui tenterait de convaincre, mais plutôt chercher une mise en récit proche d’un déploiement de pensées, qui donne une impression, une sensation globale et multiple du monde, quelque chose qui ne polariserait pas la perception des personnes à qui je partagerais ce/ces récits.
J’ai commencé par interroger les récits de réussite. Qui servent-ils? Que servent-ils? Qu’est-ce que réussir? Dans les fictions dominantes, il s’agit de se démarquer (au mieux) ou plus souvent, de dominer, d’être au-dessus de.
Ma recherche pourrait donc se formuler aujourd’hui comme ceci:
Comment créer des fictions qui ne nous écrasent pas, qui ne prennent pas le pouvoir sur nos imaginaires? Des fictions-polyphonies qui donneraient voix aux personnages secondaires, humains ou pas, des fictions dominantes.
Comment, au plateau, ne pas imposer une vision du monde, mais suggérer des interrogations?
Comment, au plateau toujours, ne pas prendre le pouvoir sur les spectateur·ices?
Peut-être en donnant à voir la fabrique du/des récit·s, et donc aussi sa fabrique formelle : ne rien cacher, tout faire à vue.
Quels médiums pour ces polyphonies?
Si les récits sont relatés sans liens volontaires, que se passe-t-il?
Tenter ici d’accumuler des matières, des manières d’écrire, afin de m’essayer à des compositions proches d’un paysage, d’un écosystème, où se côtoient, presque par chance, des espèces qui n’ont en commun que l’espace qu’elles habitent. Chacune ayant son propre « langage », sa temporalité, sa forme, son rythme…
Cet enchâssement/enchevêtrement – que je nomme, pompeusement, «enchâssevêtrement» – aurait pour objectif d’agrandir nos vues, nos fenêtres sur le réel, à commencer par les miennes…
Comment aborder tout ceci de façon ludique?
Trouver le ton, l’humour, pour créer une pertinente impertinence.
C’est une recherche en cours, je m’engage à chercher dans ces directions, on verra ce que j’y découvrirai.
Sarah Hebborn, octobre 2025
¹ STENGERS Isabelle, «Ursula Le Guin – Penser en mode SF», dans Epistémocritique – Revue de littérature et savoirs, Hors-Série 2020 – Le Guin / Stengers: aventures de pensées.
Image: Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France © Clément Maurice

Photo: © Pierre Liebaert
Parcours à L'L
Après dépôt de candidature, Sarah Hebborn entame sa recherche à L’L en mars 2023.
Sarah Hebborn suit une formation d’actrice à l’ESACT (Liège) dont elle sort diplômée en 2012. Durant ses études, elle fait des rencontres heureuses, notamment ses futur·es collègues du collectif La Station (Cédric Coomans, Eléna Doratiotto et Daniel Schmitz) avec qui elle crée Ivan (2012), Gulfstream (2014), Parc (2019) et Fani, Filip et les Fantômes (2025).
Avec le collectif Une Tribu, elle crée La Course (2017) et Au Pied des Montagnes (2021). Cette dernière pièce l’amène à co-écrire avec Gwendoline Gauthier un roman illustré par Fanny Dreyer, publié chez Versant Sud (2025), et à créer également, toujours avec Gwendoline, une fiction sonore réalisée par Thomas Turine (2025).
Entre 2021 et 2022, elle écrit une pièce, Croisières, grâce à différents accueils en résidence (à Gallait 80, au CED-WB, à La Chartreuse et au BAMP).
En 2025, elle crée une forme courte avec Éline Schumacher, Elles se sont méfiées du loup mais elles n’avaient pas vu le crocodile.
En parallèle, elle mène régulièrement des ateliers (de théâtre et théâtre d’ombres) en milieu scolaire, associatif et en centre d’aide à la santé mentale.